Raimond Bérenger (11 -1248)
Raimond Bérenger est déjà prévôt de Fréjus le 20 mai 1223 lorsqu’il teste aux Arcs avec ce titre. Il reçoit du comte de Provence, au mois d'août 1223, la confirmation des privilèges de l'Eglise de Fréjus. Avec l'évêque Bertrand de Favas, il obtint aussi, au mois de mars 1225, le privilège de la gabelle du sel; il assiste, comme témoin, le 28 mai suivant, au consentement donné par l'évêque à la donation faite aux Templiers de la maison de Rue ; le 27 août de la même année, Bertrand de Favas paie pour lui à Guillaume de Fayence quarante livres qu'il lui devait. En 1226, le prévôt Raimond Bérenger est témoin de l'hommage prêté à Riez par Boniface de Castellane à son homonyme Raymond Bérenger, comte de Provence, pour les fiefs de Salernes, Villecroze et Entrecasteaux.  Enfin, le 24 juillet 1227, il assiste à la cession du consulat de Grasse faite par les habitants au comte de Provence. La dernière mention connue du prévôt Raimond Bérenger date du 28 juillet 1234 où il est cité dans un acte passé à Aix. Quelques mois plus tard, probablement au tout début de l’année 1235, il accède à l’épiscopat et succède à l’évêque de Fréjus Bertrand de Favas, mort en décembre 1234. La prévôté passe alors à Fouques de Caille. Au cours de son pontificat, Raimond Bérenger travaille et assiste au mariage si lourd de conséquence entre l’héritière de Provence, Béatrice et Charles d’Anjou, en 1246. Il tombe malade peu après et meurt le 16 décembre, probablement de l’année 1248, après une vieillesse douloureuse.
Enfin, le 24 juillet 1227, il assiste à la cession du consulat de Grasse faite par les habitants au comte de Provence. La dernière mention connue du prévôt Raimond Bérenger date du 28 juillet 1234 où il est cité dans un acte passé à Aix. Quelques mois plus tard, probablement au tout début de l’année 1235, il accède à l’épiscopat et succède à l’évêque de Fréjus Bertrand de Favas, mort en décembre 1234. La prévôté passe alors à Fouques de Caille. Au cours de son pontificat, Raimond Bérenger travaille et assiste au mariage si lourd de conséquence entre l’héritière de Provence, Béatrice et Charles d’Anjou, en 1246. Il tombe malade peu après et meurt le 16 décembre, probablement de l’année 1248, après une vieillesse douloureuse.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

 Honnoré Ricaudy naît à Sisteron le 19 décembre 1762. Il est le fils d’Henry Ricaudy, avocat au Parlement de Paris, lui-même fils d’avocat et petit-fils de notaire sisteronais, sa mère se nomme Elisabeth Lantier. L’enfant est baptisé le même jour et reçoit comme parrain son cousin issu de germain, fils du viguier et premier capitaine de Sisteron, le jeune Henry de Burle de Curban, qui est aussi le filleul d’Henry Ricaudy. Le nouveau baptisé s’inscrit d'emblée dans un réseau familial et social qui se partage les charges publiques et ecclésiastiques. Assiste au baptême le frère du parrain, Honoré-Alexandre de Burle d’Aujarde qui, docteur en théologie, deviendra curé des Mées en 1784, mais aussi un « Ricaudy, prêtre », soit l'oncle Joseph Ricaudy (1722-1792), mort chanoine du ci-devant chapitre de Sisteron, soit l'autre oncle, Honoré Ricaudy (1723-1801), licencié en théologie, qui cumulera très vite de nombreux bénéfices : chanoine et grand-vicaire de Sisteron, prieur de la chapelle Saint-Sébastien de Reynier en 1763, dernier prévôt de Chardavon, nommé à ce prieuré du diocèse de Gap le 28 novembre 1766, puis chapelain de quartier de Madame Marie-Joséphine de Savoie, épouse du comte de Provence (le futur Louis XVIII) et qui mourra à Paris après avoir un temps émigré. Honnoré le jeune entre à son tour dans les ordres et, après avoir été reçu docteur en théologie, semble avoir été lui-même intégré au chapitre cathédral de Sisteron où il occupe la stalle de théologal laissée vacante par la mort de Messire Simon-Bruno Gantheaume, en 1786. Après la tourmente révolutionnaire, le ci-devant chanoine Ricaudy retrouva une stalle dans le chapitre de Digne reconstitué à partir de 1803, puis fut aussi nommé président de la fabrique de la cathédrale de cette même ville. Mgr de Richery lui donne le titre de chanoine honoraire et de vicaire général de Fréjus en 1824. Bien que résidant à Digne, le chanoine Ricaudy meurt dans son domaine du Logis-Neuf, à Sisteron le 9 octobre 1832. Les descendants de son frère Henry-Joseph de Ricaudy (1758-1818), conseiller du roi, président trésorier général de France au bureau des finances et chambre du domaine du Dauphiné, grand voyer de ladite province, établis à Toulon, s’illustreront dans la marine comme Cyprien-Alphonse-Didier de Ricaudy (1823-1912) qui fera les campagnes d’Orient (1855-56) et d’Italie (1859-60), Louis-Théodore-Bernard de Ricaudy (1834-1924) ou Louis-Alphonse-Dominique de Ricaudy (1839-1898).
Honnoré Ricaudy naît à Sisteron le 19 décembre 1762. Il est le fils d’Henry Ricaudy, avocat au Parlement de Paris, lui-même fils d’avocat et petit-fils de notaire sisteronais, sa mère se nomme Elisabeth Lantier. L’enfant est baptisé le même jour et reçoit comme parrain son cousin issu de germain, fils du viguier et premier capitaine de Sisteron, le jeune Henry de Burle de Curban, qui est aussi le filleul d’Henry Ricaudy. Le nouveau baptisé s’inscrit d'emblée dans un réseau familial et social qui se partage les charges publiques et ecclésiastiques. Assiste au baptême le frère du parrain, Honoré-Alexandre de Burle d’Aujarde qui, docteur en théologie, deviendra curé des Mées en 1784, mais aussi un « Ricaudy, prêtre », soit l'oncle Joseph Ricaudy (1722-1792), mort chanoine du ci-devant chapitre de Sisteron, soit l'autre oncle, Honoré Ricaudy (1723-1801), licencié en théologie, qui cumulera très vite de nombreux bénéfices : chanoine et grand-vicaire de Sisteron, prieur de la chapelle Saint-Sébastien de Reynier en 1763, dernier prévôt de Chardavon, nommé à ce prieuré du diocèse de Gap le 28 novembre 1766, puis chapelain de quartier de Madame Marie-Joséphine de Savoie, épouse du comte de Provence (le futur Louis XVIII) et qui mourra à Paris après avoir un temps émigré. Honnoré le jeune entre à son tour dans les ordres et, après avoir été reçu docteur en théologie, semble avoir été lui-même intégré au chapitre cathédral de Sisteron où il occupe la stalle de théologal laissée vacante par la mort de Messire Simon-Bruno Gantheaume, en 1786. Après la tourmente révolutionnaire, le ci-devant chanoine Ricaudy retrouva une stalle dans le chapitre de Digne reconstitué à partir de 1803, puis fut aussi nommé président de la fabrique de la cathédrale de cette même ville. Mgr de Richery lui donne le titre de chanoine honoraire et de vicaire général de Fréjus en 1824. Bien que résidant à Digne, le chanoine Ricaudy meurt dans son domaine du Logis-Neuf, à Sisteron le 9 octobre 1832. Les descendants de son frère Henry-Joseph de Ricaudy (1758-1818), conseiller du roi, président trésorier général de France au bureau des finances et chambre du domaine du Dauphiné, grand voyer de ladite province, établis à Toulon, s’illustreront dans la marine comme Cyprien-Alphonse-Didier de Ricaudy (1823-1912) qui fera les campagnes d’Orient (1855-56) et d’Italie (1859-60), Louis-Théodore-Bernard de Ricaudy (1834-1924) ou Louis-Alphonse-Dominique de Ricaudy (1839-1898).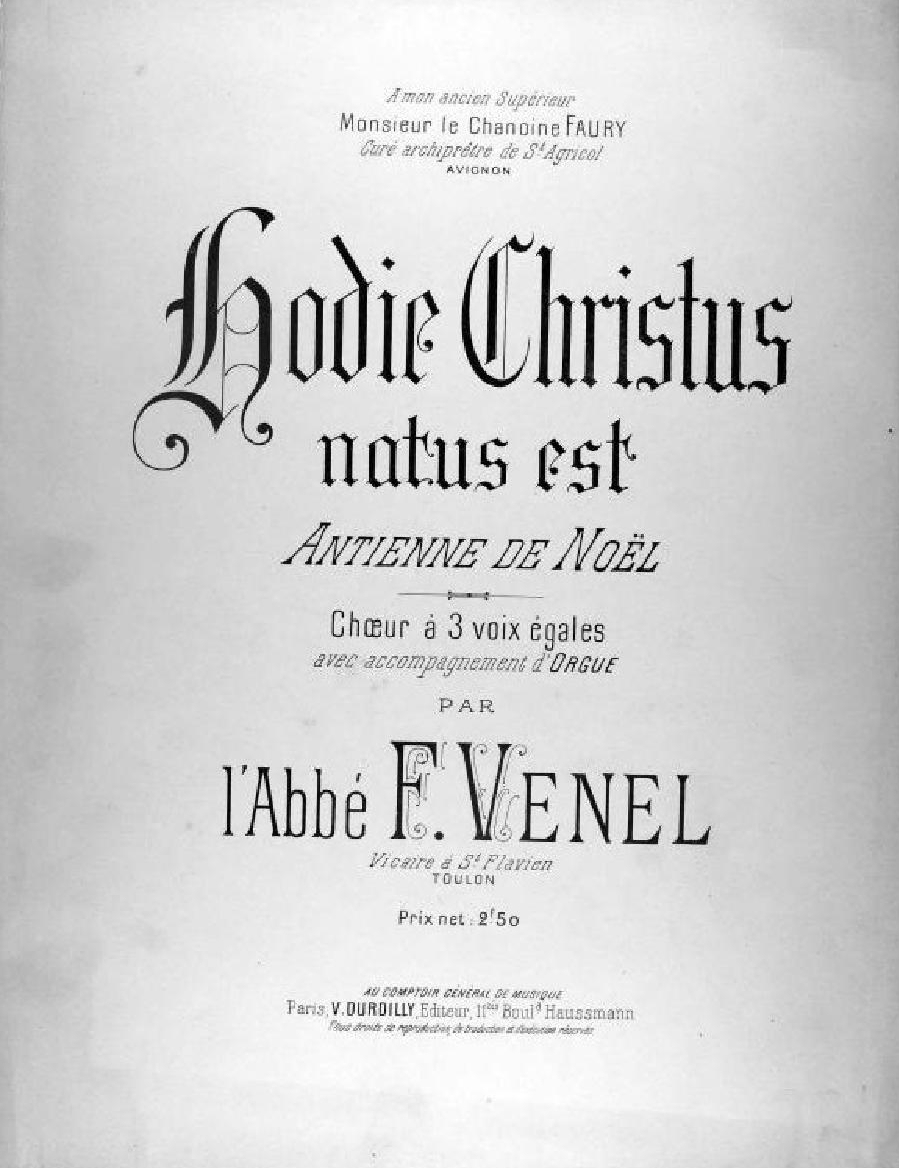
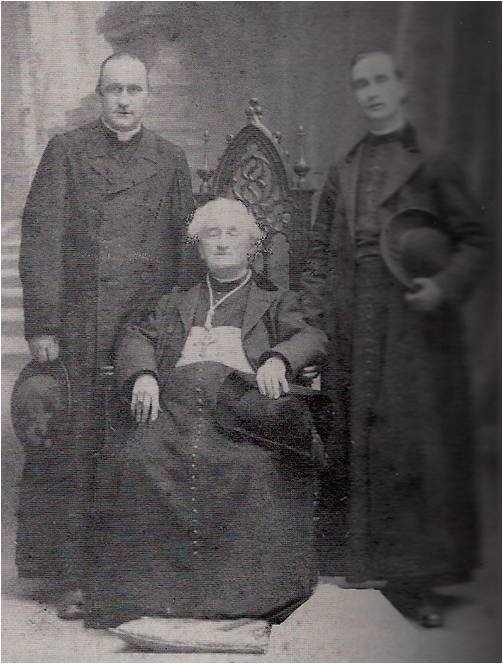 Angelo-Maria-Filippo Sinibaldi naît le 14 avril 1846 à Gavignano, patrie d’Innocent III, village du Latium situé entre Segni et Anagni. Il entre au petit séminaire de Segni le 4 septembre 1860 pour y faire ses études classiques puis poursuit sa formation théologique au Séminaire romain. Filippo Sinibaldi est ordonné prêtre le 18 décembre 1869, dix jours après l’ouverture du concile Vatican I, des mains du cardinal Vicaire, Costantino Patrizi. Il poursuit encore quelque temps des études de droit avant d’être nommé professeur de philosophie et d’Ecriture Sainte au séminaire de Segni, puis devient archiprêtre de Cori (sud-est de Velletri). Après deux ans et demi de charge pastorale, il est choisi comme vicaire général de l’évêque de Segni, par la volonté du pape Léon XIII, et fait chanoine de Segni. Il est ensuite élu évêque auxiliaire d’Ostie avec le titre d’évêque d’Europos, le 14 décembre 1904 et sacré quatre jours plus tard par le cardinal Boschi. L’année suivante, Mgr Arnaud lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus : « Sa Grandeur, Mgr Philippe Sinibaldi, évêque administrateur perpétuel du diocèse d’Ostie & Velletri a bien voulu agréer le titre de chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus ». Le mardi 14 novembre 1905, Mgr Sinibaldi fait une visite à Fréjus : après s’être rendu au séminaire, il est allé prier sur la tombe de Mgr Arnaud qui l’avait fait chanoine d’honneur peu de temps avant de s’éteindre en juin. Le 16 avril 1915, Mgr Filippo Sinibaldi est promu évêque de Segni où il meurt le 20 avril 1928.
Angelo-Maria-Filippo Sinibaldi naît le 14 avril 1846 à Gavignano, patrie d’Innocent III, village du Latium situé entre Segni et Anagni. Il entre au petit séminaire de Segni le 4 septembre 1860 pour y faire ses études classiques puis poursuit sa formation théologique au Séminaire romain. Filippo Sinibaldi est ordonné prêtre le 18 décembre 1869, dix jours après l’ouverture du concile Vatican I, des mains du cardinal Vicaire, Costantino Patrizi. Il poursuit encore quelque temps des études de droit avant d’être nommé professeur de philosophie et d’Ecriture Sainte au séminaire de Segni, puis devient archiprêtre de Cori (sud-est de Velletri). Après deux ans et demi de charge pastorale, il est choisi comme vicaire général de l’évêque de Segni, par la volonté du pape Léon XIII, et fait chanoine de Segni. Il est ensuite élu évêque auxiliaire d’Ostie avec le titre d’évêque d’Europos, le 14 décembre 1904 et sacré quatre jours plus tard par le cardinal Boschi. L’année suivante, Mgr Arnaud lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus : « Sa Grandeur, Mgr Philippe Sinibaldi, évêque administrateur perpétuel du diocèse d’Ostie & Velletri a bien voulu agréer le titre de chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus ». Le mardi 14 novembre 1905, Mgr Sinibaldi fait une visite à Fréjus : après s’être rendu au séminaire, il est allé prier sur la tombe de Mgr Arnaud qui l’avait fait chanoine d’honneur peu de temps avant de s’éteindre en juin. Le 16 avril 1915, Mgr Filippo Sinibaldi est promu évêque de Segni où il meurt le 20 avril 1928.