Célestin Chapeau (1874-1951)
Célestin-Louis Chapeau naît à Marseille le 27 août 1873, fils d’Adolphe-Fortuné Chapeau, menuisier en voitures, et de Baptistine-Marie Lehénaf. Au grand séminaire de Fréjus qui est alors autorisé à donner des grades, il est reçu bachelier en théologie. Ordonné sous-diacre pour le diocèse de Fréjus le 3 mars 1897, il est prêtre le 29 juin 1897. On le nomme d’abord au petit séminaire de Brignoles puis, le 20 octobre 1878, vicaire à Flayosc, où il s’occupe particulièrement des enfants. En 1902, il est vicaire à Lorgues. Avec son tempérament bouillant, il y affronte sans détours les anticléricaux, notamment lors de l’expulsion des religieuses quand il provoque l’hilarité générale en assénant un coup de poing sur le haut-de-forme d’un des représentants de l’Etat, qui lui descend jusqu’au menton, ce qui lui vaut une suspension de traitement et une amende de 100 francs … Transféré à La Valette le 1er décembre 1906, il est affecté toujours comme vicaire à Hyères le 11 novembre 1906. L’abbé Chapeau devient curé d’Entrecasteaux le 1er juin 1913, puis sera presqu’immédiatement muté à Cogolin dont il est curé du  1er septembre 1913 au 16 octobre 1937. C’est dans cette dernière paroisse qu’il donnera toute sa mesure, il y exerce ses talents de photographe (C’est un photographe, Théodore Devaugermé, qui avait été un des témoins lors de sa déclaration de naissance…), de poète (il a laissé de nombreuses poésies et une étude illustrée sur la presqu’île de Giens), mais surtout de pasteur entièrement donné à sa paroisse qu’il dote de façon magnifique. On le reconnaît comme intelligent, travailleur zélé et consciencieux et pieux. Le 16 octobre 1937, l’abbé Chapeau est nommé curé de Saint-Cyprien, à Toulon. La guerre qui éclate bientôt, durant laquelle il n’abandonne pas ses paroissiens l’empêcha de donner tout son plein. Il sera néanmoins fait chanoine honoraire en 1942. Et surtout un accident malheureux survenu en 1945 ralentira sa vie sacerdotale jusque-là si pleine de vitalité. Messire Célestin-Louis Chapeau, malgré sa très forte constitution et en contraste avec les tendances de son caractère bouillant doit supporter le handicap ; il entre alors dans un long calvaire physique et moral, même s’il en accepte spirituellement les conséquences. C’est finalement une embolie qui l’emporte subitement à Toulon le 15 février 1951. Jeune, il avait publié une plaquette intitulée A travers la presqu'île de Giens, qui en donnait une description à la fois pittoresque et rigoureuse.
1er septembre 1913 au 16 octobre 1937. C’est dans cette dernière paroisse qu’il donnera toute sa mesure, il y exerce ses talents de photographe (C’est un photographe, Théodore Devaugermé, qui avait été un des témoins lors de sa déclaration de naissance…), de poète (il a laissé de nombreuses poésies et une étude illustrée sur la presqu’île de Giens), mais surtout de pasteur entièrement donné à sa paroisse qu’il dote de façon magnifique. On le reconnaît comme intelligent, travailleur zélé et consciencieux et pieux. Le 16 octobre 1937, l’abbé Chapeau est nommé curé de Saint-Cyprien, à Toulon. La guerre qui éclate bientôt, durant laquelle il n’abandonne pas ses paroissiens l’empêcha de donner tout son plein. Il sera néanmoins fait chanoine honoraire en 1942. Et surtout un accident malheureux survenu en 1945 ralentira sa vie sacerdotale jusque-là si pleine de vitalité. Messire Célestin-Louis Chapeau, malgré sa très forte constitution et en contraste avec les tendances de son caractère bouillant doit supporter le handicap ; il entre alors dans un long calvaire physique et moral, même s’il en accepte spirituellement les conséquences. C’est finalement une embolie qui l’emporte subitement à Toulon le 15 février 1951. Jeune, il avait publié une plaquette intitulée A travers la presqu'île de Giens, qui en donnait une description à la fois pittoresque et rigoureuse.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

 par Mgr Simeone le 22 juin 1937. Après trois années d’études au Séminaire français de Rome, il est reçu docteur en théologie. De retour dans le diocèse, lui est confiée la chaire de théologie dogmatique au grand séminaire de la Castille, qu’il occupe de 1939 à 1944. Il aborde ensuite le ministère paroissial comme pro-curé de la paroisse St-Cyprien, de Toulon, au temps de Mgr Chapeau, et le remplace comme curé en 1951. Mgr Gaudel l’honore du titre de chanoine honoraire en août 1960. A cause de son état de santé, il est obligé de quitter la paroisse en 1966, après plus de vingt ans dans ce quartier de Saint-Jean-du-Var. Il accepte cependant la charge de curé du Pradet où il se dévouera encore six ans. Il meurt le 20 janvier 1973 à l’âge de 59 ans, dans son pays natal, où il est inhumé.
par Mgr Simeone le 22 juin 1937. Après trois années d’études au Séminaire français de Rome, il est reçu docteur en théologie. De retour dans le diocèse, lui est confiée la chaire de théologie dogmatique au grand séminaire de la Castille, qu’il occupe de 1939 à 1944. Il aborde ensuite le ministère paroissial comme pro-curé de la paroisse St-Cyprien, de Toulon, au temps de Mgr Chapeau, et le remplace comme curé en 1951. Mgr Gaudel l’honore du titre de chanoine honoraire en août 1960. A cause de son état de santé, il est obligé de quitter la paroisse en 1966, après plus de vingt ans dans ce quartier de Saint-Jean-du-Var. Il accepte cependant la charge de curé du Pradet où il se dévouera encore six ans. Il meurt le 20 janvier 1973 à l’âge de 59 ans, dans son pays natal, où il est inhumé.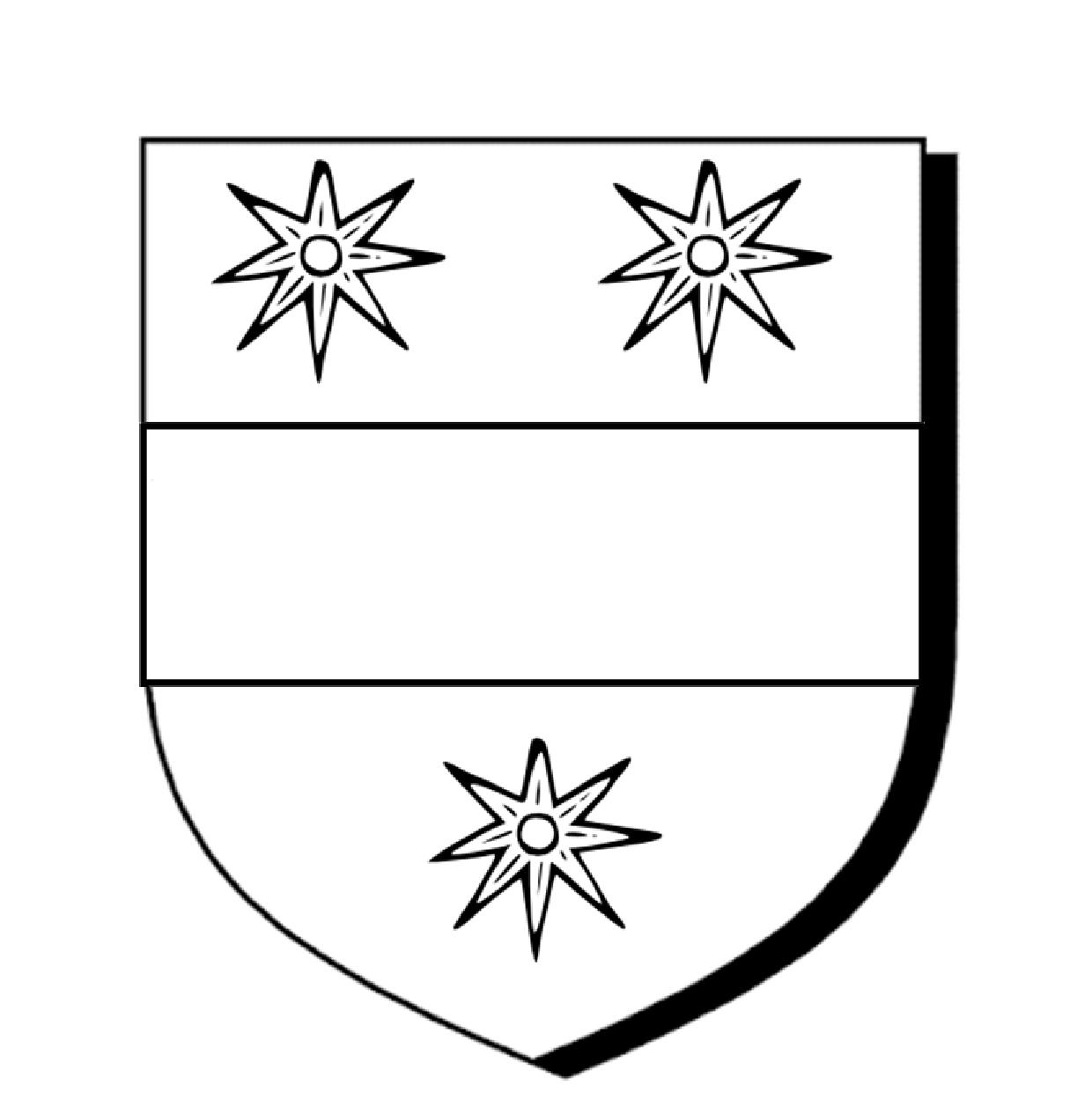

 Jacques-Frédéric Graly naît à Paulhaguet (Haute-Loire) le 11 avril 1872, fils de Claude Graly, receveur des postes et d’Anne Blazy. L’enfant est confié à l’école apostolique de Montluçon dirigée par les Pères Maristes ; naturellement sa vocation s’orientera vers cette congrégation. Ayant obtenu à la faculté de Lyon une licence ès sciences, il fit profession religieuse dans la Société de Marie le 27 décembre 1897. A la fin de ses études philosophiques et théologiques, il est ordonné prêtre le 29 mars 1902 et aussitôt envoyé à l’Institution Saint-Joseph de Montluçon pour y enseigner les mathématiques élémentaires. Déjà se manifeste la caractéristique de sa vie sacerdotale : le dévouement à l’Eglise et la serviabilité à l’égard de ses confrères. Fin lettré et excellent diseur, il aime la prédication à laquelle il s’adonne aussi dans le diocèse de Moulins. C’est en 1914 qu’il est affecté dans le diocèse de Fréjus et Toulon, appelé à remplacer le supérieur du collège Sainte-Marie de La Seyne, le Père Delaunay. Le Père Graly commence son supériorat dans des conditions particulièrement difficiles : l’établissement est réquisitionné pour abriter un hôpital militaire russe et se trouve replié en partie sur l’ancien couvent de la Présentation depuis longtemps abandonné et en piteux état. Le nouveau supérieur supervise les travaux d’urgence avant d’être lui-même appelé sous les drapeaux où il servira comme infirmier et dont, parti comme sergent, il rentrera le 3 mars 1919 lieutenant d’infanterie avec une citation et la croix de guerre. Durant toute cette période, il ne pourra être présent à La Seyne que lors de rares permissions. La paix revenue, tout était à réorganiser à l’Institution Sainte-Marie : il réintègre les bâtiments du collège et permet un retour progressif aux usages réguliers, puis veille avec patience, méthode et scrupule à la réfection de l’édifice, à la reconstitution du corps professoral et à l’introduction de méthodes plus fructueuses. Il marque ainsi durablement l’établissement qu’il dirigera jusqu’en 1941, mais aussi par sa gentillesse et sa piété toute mariale. Il avait reçu de Mgr Guillibert le camail de chanoine honoraire de Fréjus en 1924. Elu provincial de sa congrégation, il doit résider à Lyon à partir de 1941, mais la maladie commence à l’affecter au point de l’obliger à se retirer en 1947 à la maison des Pères Maristes de Belley. C’est là qu’il meurt le dimanche 28 octobre 1951.
Jacques-Frédéric Graly naît à Paulhaguet (Haute-Loire) le 11 avril 1872, fils de Claude Graly, receveur des postes et d’Anne Blazy. L’enfant est confié à l’école apostolique de Montluçon dirigée par les Pères Maristes ; naturellement sa vocation s’orientera vers cette congrégation. Ayant obtenu à la faculté de Lyon une licence ès sciences, il fit profession religieuse dans la Société de Marie le 27 décembre 1897. A la fin de ses études philosophiques et théologiques, il est ordonné prêtre le 29 mars 1902 et aussitôt envoyé à l’Institution Saint-Joseph de Montluçon pour y enseigner les mathématiques élémentaires. Déjà se manifeste la caractéristique de sa vie sacerdotale : le dévouement à l’Eglise et la serviabilité à l’égard de ses confrères. Fin lettré et excellent diseur, il aime la prédication à laquelle il s’adonne aussi dans le diocèse de Moulins. C’est en 1914 qu’il est affecté dans le diocèse de Fréjus et Toulon, appelé à remplacer le supérieur du collège Sainte-Marie de La Seyne, le Père Delaunay. Le Père Graly commence son supériorat dans des conditions particulièrement difficiles : l’établissement est réquisitionné pour abriter un hôpital militaire russe et se trouve replié en partie sur l’ancien couvent de la Présentation depuis longtemps abandonné et en piteux état. Le nouveau supérieur supervise les travaux d’urgence avant d’être lui-même appelé sous les drapeaux où il servira comme infirmier et dont, parti comme sergent, il rentrera le 3 mars 1919 lieutenant d’infanterie avec une citation et la croix de guerre. Durant toute cette période, il ne pourra être présent à La Seyne que lors de rares permissions. La paix revenue, tout était à réorganiser à l’Institution Sainte-Marie : il réintègre les bâtiments du collège et permet un retour progressif aux usages réguliers, puis veille avec patience, méthode et scrupule à la réfection de l’édifice, à la reconstitution du corps professoral et à l’introduction de méthodes plus fructueuses. Il marque ainsi durablement l’établissement qu’il dirigera jusqu’en 1941, mais aussi par sa gentillesse et sa piété toute mariale. Il avait reçu de Mgr Guillibert le camail de chanoine honoraire de Fréjus en 1924. Elu provincial de sa congrégation, il doit résider à Lyon à partir de 1941, mais la maladie commence à l’affecter au point de l’obliger à se retirer en 1947 à la maison des Pères Maristes de Belley. C’est là qu’il meurt le dimanche 28 octobre 1951.