Charles Martel (1838-1917)
Joseph-Charles (parfois appelé Charles-Joseph-Louis) Martel naît à Pignans le 24 février 1838, de Joseph-Louis Martel, marchand de bois, et de Marianne-Rosalie Dolioulle. Son père, fils de Marie-Reine Borme, se trouve être le cousin germain du chanoine Joseph-Antoine Borme qui exerça sur lui une influence décisive. A l’issue de sa formation cléricale, Charles est ordonné sous-diacre le 4 mai 1862, et prêtre le 21 mai 1864. Il exerça son ministère d’abord comme vicaire à La Cadière, à partir du 13 juillet 1864. Il fut ensuite nommé professeur au petit séminaire de Brignoles le 10 octobre 1864, avant de reprendre une activité paroissiale d’abord comme vicaire au Val où il est nommé le 18 novembre 1865, puis à Saint-Maximin dès le 1er janvier 1868, à Fréjus le 1er octobre 1869, puis à La Seyne le 1er octobre 1874. Il devient ensuite recteur de La Môle le 1er novembre 1878, avant d’être envoyé comme aumônier de l’hospice d’Hyères le 15 juin 1882. C’est le 3 juillet 1892 que Monseigneur Mignot lui confère la dignité de chanoine honoraire de sa cathédrale. Le chanoine Martel meurt à Hyères le 16 février 1917, à l’âge de 78 ans.
Reprenant l’ouvrage du chanoine Borme, Charles Martel avait publié en 1916 un résumé du travail historique réalisé par son oncle sur le sanctuaire marial de leur village, intitulé « Le culte de Marie et le sanctuaire de Notre-Dame des Anges à Pignans. Diocèse de Fréjus ». Précédemment, on lui doit aussi quelques opuscules d’apologétique : « Dominicales, ou Cinquante-deux instructions tirées des Évangiles de tous les dimanches de l'année et suivies de plusieurs tables à l'usage des prédicateurs », deux volumes parus en 1912 chez Brunet, à Arras. C’est lui qui réalisa le premier des sept tomes qui portent le titre « Dominicales, d'après saint Bonaventure », avec comme sous-titre : « La Chaire au XIXe siècle, ou le Missionnaire de la ville et de la campagne, suivi d'un sommaire ou panorama de la prédication. Recueil de conférences, sermons, panégyriques, discours de circonstances, etc., etc., d'après NN. SS. les évêques, les RR. PP. des divers ordres religieux, missionnaires apostoliques et autres prêtres distingués », édités par la Librairie St-Thomas d’Aquin de Marseille en 1897. La même qui avait publié en 1890 son « Recueil de pensées chrétiennes ». Mais on lui doit bien d'autres ouvrages encore : une édition critique du Panarium de Jan Buys, le Viridarium, les Méditations ou Plans d'instructions (1900), etc.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.


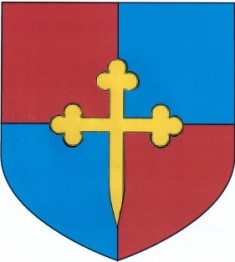 François de Thomas
François de Thomas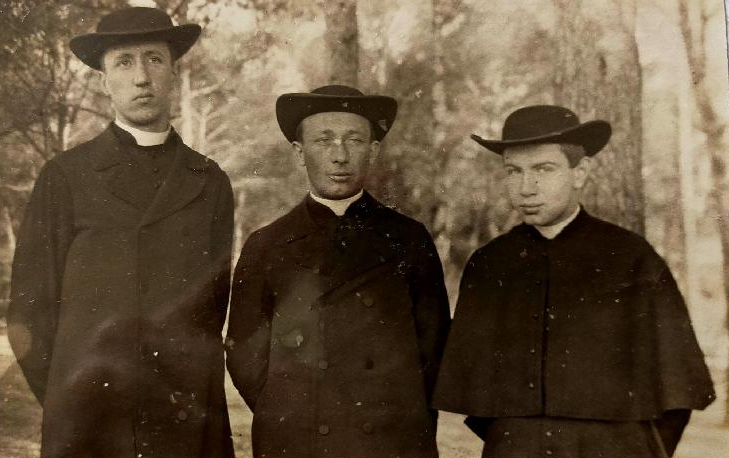 Jean-Achille-Marie Ballivet naît à Uzès le 20 mai 1900, fils d'Hippolyte Ballivet, d'une famille originaire du Gard, alors lieutenant au 58° régiment d'infanterie, et de Marie-Louise Vaillant issue d'une famille d'officiers de Marine implantée à Toulon. Alors que son oncle, le contre-amiral de réserve Aimé Clément, basé à Toulon allait être promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur, Jean a la douleur de perdre son père le 10 décembre 1914 : devenu officier d'infanterie au 4°RZM, celui-ci est tué à son poste de commandement à Ypres. Après ses études ecclésiastiques à Fréjus, c’est au tout nouveau
Jean-Achille-Marie Ballivet naît à Uzès le 20 mai 1900, fils d'Hippolyte Ballivet, d'une famille originaire du Gard, alors lieutenant au 58° régiment d'infanterie, et de Marie-Louise Vaillant issue d'une famille d'officiers de Marine implantée à Toulon. Alors que son oncle, le contre-amiral de réserve Aimé Clément, basé à Toulon allait être promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur, Jean a la douleur de perdre son père le 10 décembre 1914 : devenu officier d'infanterie au 4°RZM, celui-ci est tué à son poste de commandement à Ypres. Après ses études ecclésiastiques à Fréjus, c’est au tout nouveau  séminaire de la Castille où il a pu les achever que Jean est ordonné sous-diacre le 29 juin 1924. Le 20 septembre suivant, Mgr Guillibert lui confère le sacerdoce en la cathédrale de Toulon. L’abbé Ballivet est immédiatement affecté comme professeur au petit séminaire d’Hyères, dès la rentrée d’octobre 1924. Un an après (octobre 1925), il est envoyé en études au séminaire français de Rome où il est reçu docteur en théologie en 1927. En octobre de la même année, le jeune diplômé est chargé de la chaire de philosophie au grand séminaire de la Castille, il y enseignera aussi l'histoire ecclésiastique. Il faudra attendre le 27 août 1934 pour que l’abbé Ballivet fasse l’expérience d’un ministère paroissial, avec la fonction de vicaire à Sainte-Marie de Toulon. Le 21 mai 1938 il regagne le monde enseignant, mais comme aumônier du lycée de Toulon, avec le titre de doyen honoraire. Il est ensuite promu directeur diocésain de l’enseignement religieux, le 16 octobre 1942. C’est le 16 décembre 1943 qu’on lui confie la cure de Sainte-Marie dont il avait été autrefois vicaire, et qu’il devient chanoine honoraire. Le chanoine Ballivet restera à ce poste jusqu’à la fin de l'année 1969. A cause de la situation et de peur que l’évêque, qui réside encore
séminaire de la Castille où il a pu les achever que Jean est ordonné sous-diacre le 29 juin 1924. Le 20 septembre suivant, Mgr Guillibert lui confère le sacerdoce en la cathédrale de Toulon. L’abbé Ballivet est immédiatement affecté comme professeur au petit séminaire d’Hyères, dès la rentrée d’octobre 1924. Un an après (octobre 1925), il est envoyé en études au séminaire français de Rome où il est reçu docteur en théologie en 1927. En octobre de la même année, le jeune diplômé est chargé de la chaire de philosophie au grand séminaire de la Castille, il y enseignera aussi l'histoire ecclésiastique. Il faudra attendre le 27 août 1934 pour que l’abbé Ballivet fasse l’expérience d’un ministère paroissial, avec la fonction de vicaire à Sainte-Marie de Toulon. Le 21 mai 1938 il regagne le monde enseignant, mais comme aumônier du lycée de Toulon, avec le titre de doyen honoraire. Il est ensuite promu directeur diocésain de l’enseignement religieux, le 16 octobre 1942. C’est le 16 décembre 1943 qu’on lui confie la cure de Sainte-Marie dont il avait été autrefois vicaire, et qu’il devient chanoine honoraire. Le chanoine Ballivet restera à ce poste jusqu’à la fin de l'année 1969. A cause de la situation et de peur que l’évêque, qui réside encore à Fréjus, soit dans l’incapacité d’administrer cette partie du territoire du diocèse, le chanoine Ballivet reçoit le 10 juin 1944 les pouvoirs de l’Ordinaire pour la région de Toulon, avec le titre de vicaire général pro spiritualibus, urgente causa. Après guerre, il est fait official provisoire, le 17 février 1947. On lui donne encore la charge de secrétaire de la section diocésaine de la mutuelle Saint-Martin le 7 juillet 1950. Il devient enfin chanoine titulaire le 12 janvier 1958, jour de l’exécution du transfert du siège épiscopal de Fréjus à Toulon. Le chanoine Ballivet est fait prélat de Sa Sainteté en avril 1961. Début janvier 1969, lors de la première visite de Mgr Marcel Lefebvre à Toulon (la seconde aura lieu le 9 mai suivant), Mgr Ballivet accueille l’évêque qui vient tout juste d’ouvrir un séminaire à Fribourg et lui permet de célébrer la messe dans la « chapelle des parements » sans y assister toutefois, « bien qu’étant favorable ». Il reçut ensuite le prélat qui n’était alors l’objet d’aucune sanction, dans son bureau. Mgr Ballivet assume la fonction de chancelier de l’évêché à partir du 29 novembre 1969, ce qui l’amène à quitter sa charge curiale. Après une vie toute donnée au service du diocèse, il s’éteint le 23 avril 1972 à Toulon.
à Fréjus, soit dans l’incapacité d’administrer cette partie du territoire du diocèse, le chanoine Ballivet reçoit le 10 juin 1944 les pouvoirs de l’Ordinaire pour la région de Toulon, avec le titre de vicaire général pro spiritualibus, urgente causa. Après guerre, il est fait official provisoire, le 17 février 1947. On lui donne encore la charge de secrétaire de la section diocésaine de la mutuelle Saint-Martin le 7 juillet 1950. Il devient enfin chanoine titulaire le 12 janvier 1958, jour de l’exécution du transfert du siège épiscopal de Fréjus à Toulon. Le chanoine Ballivet est fait prélat de Sa Sainteté en avril 1961. Début janvier 1969, lors de la première visite de Mgr Marcel Lefebvre à Toulon (la seconde aura lieu le 9 mai suivant), Mgr Ballivet accueille l’évêque qui vient tout juste d’ouvrir un séminaire à Fribourg et lui permet de célébrer la messe dans la « chapelle des parements » sans y assister toutefois, « bien qu’étant favorable ». Il reçut ensuite le prélat qui n’était alors l’objet d’aucune sanction, dans son bureau. Mgr Ballivet assume la fonction de chancelier de l’évêché à partir du 29 novembre 1969, ce qui l’amène à quitter sa charge curiale. Après une vie toute donnée au service du diocèse, il s’éteint le 23 avril 1972 à Toulon. Pierre Germondy
Pierre Germondy