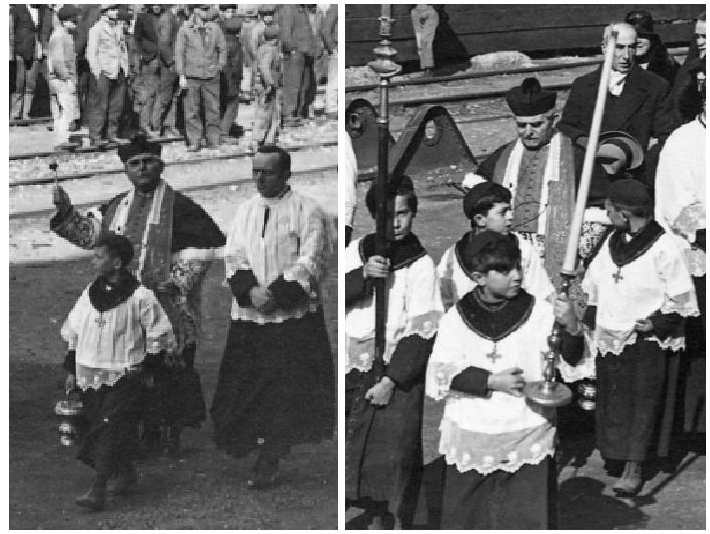Mgr Emilien Touze (1844-1930)
Louis-Jean-Baptiste-Emilien Touze naît né le 5 août 1844 à Hyères, fils d’Antonin-Louis-Grégoire Touze, jardinier, et de Louise-Catherine-Reine Sabatier. Il est ordonné prêtre le 19 septembre 1868. Il est immédiatement nommé professeur au petit séminaire de Brignoles où il avait été élève et où il se révéla un excellent maître. Il dut, au bout de sept ans prendre un temps de repos dans sa ville natale auprès de sa mère. Il est ensuite nommé aumônier de l’hospice de la ville. Il resta à Hyères huit ans comme aumônier et quinze ans comme vicaire. Il lui fut difficile de quitter sa chère cité où il se donna sans réserve, quand Mgr Mignot le nomma curé de Saint-Raphaël en 1899 où il resta seulement trois mois, car à peine arrivé, Mgr Arnaud, son successeur en fit son vicaire général et le nommait chanoine honoraire de la cathédrale, le 19 mars 1900. A la mort de l’évêque, il fut élu vicaire capitulaire le 18 juin 1905 avec le chanoine Roudier et assura la vacance du siège. A la fin de cette même année, au cours d'une visite de son ancien condisciple, Mgr Latty, venu se reposer dans sa famille à Cagnes, le chanoine Touze fut honoré du titre de chanoine honoraire de Châlons. Il redevint vicaire général de Mgr Guillibert et se montra un collaborateur extrêmement précieux au temps des spoliations, apportant notamment un soin particulier au recrutement sacerdotal. Sur proposition de l'évêque, le chanoine Touze est élevé à la dignité de Prélat de la Maison de Sa Sainteté par bref du 22 mai 1906. Pendant vingt ans, il aida Mgr Guillibert à reconstituer le diocèse sur de nouvelles bases et à soutenir les prêtres dans leurs épreuves sans cesse grandissantes. Il fut de nouveau élu vicaire capitulaire, à 82 ans, à la mort de l’évêque, en 1926. Toujours vaillant, il célèbre ses noces de diamant à Hyères en 1928 et y meurt le 6 janvier 1930. On a de lui une Notice sur la chapelle et la statue de N.-D. de Consolation à Hyères, opuscule de 24 pages (1883) et une Etude sur Massillon, opuscule de 80 pages (1897).


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

 enfants en bas âge. Sa mère les élèvera seule avec un dévouement et une piété admirables. Après de brillantes études au collège de sa ville natale dirigé par les Dominicains et illustré par le Père Lacordaire, Jean-Marcel passe à Toulouse ses deux baccalauréats où il remporte la mention très bien, à chaque fois. Il entre alors à l’école Lacordaire de Paris pour se préparer à l’Ecole Polytechnique selon les désirs de son défunt père. Il y est admis en 1898. Désormais ingénieur des chemins de fer et lieutenant, après un passage à Fontainebleau, il arrive à Toulon en 1902 et part bientôt pour le Tonkin avec la mission Billiès. Il demeure en Extrême-Orient de 1903 à 1905. Au retour, il quitte l’armée pour rentrer au séminaire de Saint-Sulpice, répondant à un appel ressenti dès sa jeunesse. Il est ordonné prêtre à Fréjus par Mgr Guillibert le 17 juillet 1910 et devient immédiatement vicaire à la cathédrale. Pendant la grande guerre, il reprend ses galons d’officier et part pour le front dès le premier jour. Il prend part
enfants en bas âge. Sa mère les élèvera seule avec un dévouement et une piété admirables. Après de brillantes études au collège de sa ville natale dirigé par les Dominicains et illustré par le Père Lacordaire, Jean-Marcel passe à Toulouse ses deux baccalauréats où il remporte la mention très bien, à chaque fois. Il entre alors à l’école Lacordaire de Paris pour se préparer à l’Ecole Polytechnique selon les désirs de son défunt père. Il y est admis en 1898. Désormais ingénieur des chemins de fer et lieutenant, après un passage à Fontainebleau, il arrive à Toulon en 1902 et part bientôt pour le Tonkin avec la mission Billiès. Il demeure en Extrême-Orient de 1903 à 1905. Au retour, il quitte l’armée pour rentrer au séminaire de Saint-Sulpice, répondant à un appel ressenti dès sa jeunesse. Il est ordonné prêtre à Fréjus par Mgr Guillibert le 17 juillet 1910 et devient immédiatement vicaire à la cathédrale. Pendant la grande guerre, il reprend ses galons d’officier et part pour le front dès le premier jour. Il prend part à la campagne de Belgique et à la bataille de la Marne. Il est nommé capitaine en mars 1915. Sa conduite héroïque à la Somme en 1916, au chemin des Dames en 1917 et à la défense de Reims lui vaut d’être fait chevalier de la Légion d’honneur, décoré de la Croix de guerre avec palme, et honoré de trois citations. Il reste encore quelque temps dans l’Allemagne occupée. Après son retour à Fréjus, il dirige pendant plusieurs années la Semaine Religieuse du diocèse et en restera le collaborateur jusqu’à son départ. Il reçoit le camail de chanoine honoraire de Fréjus en 1923, est nommé en 1924 curé-doyen du Luc, et en 1926 supérieur du Petit Séminaire Saint-Charles de Hyères. C’est de là qu’il est désigné pour devenir évêque d’Ajaccio en 1927, il devient alors chanoine d’honneur du chapitre de Fréjus. Mgr Rodié restera onze ans en Corse. Il s'efforce de réanimer le clergé corse et lutte contre les tendances italianisantes. Il développe les patronages et le scoutisme. Mgr Rodié est transféré sur le siège d'Agen en 1938. Proche de la Résistance, il est emprisonné par la Gestapo à Toulouse en juin 1944 puis déporté. Il se retire en 1956 pour servir comme aumônier d'une maison religieuse à Paris, avec le titre d’évêque titulaire de Cynopolis in Arcadia. Il meurt le 10 avril 1968. Son corps repose dans la cathédrale d'Agen.
à la campagne de Belgique et à la bataille de la Marne. Il est nommé capitaine en mars 1915. Sa conduite héroïque à la Somme en 1916, au chemin des Dames en 1917 et à la défense de Reims lui vaut d’être fait chevalier de la Légion d’honneur, décoré de la Croix de guerre avec palme, et honoré de trois citations. Il reste encore quelque temps dans l’Allemagne occupée. Après son retour à Fréjus, il dirige pendant plusieurs années la Semaine Religieuse du diocèse et en restera le collaborateur jusqu’à son départ. Il reçoit le camail de chanoine honoraire de Fréjus en 1923, est nommé en 1924 curé-doyen du Luc, et en 1926 supérieur du Petit Séminaire Saint-Charles de Hyères. C’est de là qu’il est désigné pour devenir évêque d’Ajaccio en 1927, il devient alors chanoine d’honneur du chapitre de Fréjus. Mgr Rodié restera onze ans en Corse. Il s'efforce de réanimer le clergé corse et lutte contre les tendances italianisantes. Il développe les patronages et le scoutisme. Mgr Rodié est transféré sur le siège d'Agen en 1938. Proche de la Résistance, il est emprisonné par la Gestapo à Toulouse en juin 1944 puis déporté. Il se retire en 1956 pour servir comme aumônier d'une maison religieuse à Paris, avec le titre d’évêque titulaire de Cynopolis in Arcadia. Il meurt le 10 avril 1968. Son corps repose dans la cathédrale d'Agen.