Aldebert Bompar de Lastic
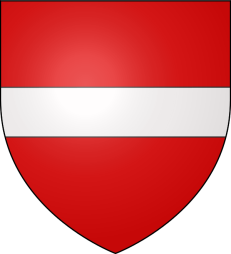 Aldebert Bompar de Lastic acquiert la prévôté de Fréjus le 2 mai 1350 par la cession que lui en fit Rodolfe du Cros en échange de bénéfices du diocèse de Cahors. Membre de cette puissante famille auvergnate particulièrement illustrée par plusieurs chanoines-comtes de Brioude du XIème au XIVème siècle, cet Aldebert est-il à identifier avec le quatrième fils d’Etienne Bompar de Lastic et de Soubeiranne de Pierrefort ? Mariés en 1298, ils donnèrent naissance à onze enfants dont deux chanoines-comtes de Brioude, deux religieuses de Lavaudieu, deux religieuses de l’abbaye Saint-Pierre de Beaumont. Aldebert, seigneur de la Chaumette, qui tient probablement son prénom de son oncle Aldebert de Pierrefort, chanoine de Rodez, comparaît comme témoin, en 1332, à l'émancipation de sa nièce, et l’année suivante à celle de son frère Etienne. Il n’est encore que simple clerc lorsque son père le désigne comme un de ses exécuteurs testamentaires le 10 juin 1334 et lui lègue quarante cinq livres tournois de rente annuelle et viagère avec la jouissance et usufruit du château de Soleyra et de Valeilles. La Gallia Christiana lui donne comme successeur à la tête du chapitre de Fréjus un certain Armand de Langeac en 1357. Aldebert pourrait être mort à cette date, mais il aurait pu aussi opérer avec lui une résignation ou un échange comme son prédécesseur l’avait fait en son temps. En faveur de cette deuxième hypothèse plaide l’âge du prévôt et la proximité géographique des deux familles qui partagent le même privilège d’alimenter le chapitre de Brioude (15 Lastic pour 17 Langeac !). Ainsi, dans la stalle du prévôt de Brioude, voit-on se succéder après les membres de la famille Roger de Beaufort, Armand de Langeac en 1383 et Dracon de Lastic en 1385…
Aldebert Bompar de Lastic acquiert la prévôté de Fréjus le 2 mai 1350 par la cession que lui en fit Rodolfe du Cros en échange de bénéfices du diocèse de Cahors. Membre de cette puissante famille auvergnate particulièrement illustrée par plusieurs chanoines-comtes de Brioude du XIème au XIVème siècle, cet Aldebert est-il à identifier avec le quatrième fils d’Etienne Bompar de Lastic et de Soubeiranne de Pierrefort ? Mariés en 1298, ils donnèrent naissance à onze enfants dont deux chanoines-comtes de Brioude, deux religieuses de Lavaudieu, deux religieuses de l’abbaye Saint-Pierre de Beaumont. Aldebert, seigneur de la Chaumette, qui tient probablement son prénom de son oncle Aldebert de Pierrefort, chanoine de Rodez, comparaît comme témoin, en 1332, à l'émancipation de sa nièce, et l’année suivante à celle de son frère Etienne. Il n’est encore que simple clerc lorsque son père le désigne comme un de ses exécuteurs testamentaires le 10 juin 1334 et lui lègue quarante cinq livres tournois de rente annuelle et viagère avec la jouissance et usufruit du château de Soleyra et de Valeilles. La Gallia Christiana lui donne comme successeur à la tête du chapitre de Fréjus un certain Armand de Langeac en 1357. Aldebert pourrait être mort à cette date, mais il aurait pu aussi opérer avec lui une résignation ou un échange comme son prédécesseur l’avait fait en son temps. En faveur de cette deuxième hypothèse plaide l’âge du prévôt et la proximité géographique des deux familles qui partagent le même privilège d’alimenter le chapitre de Brioude (15 Lastic pour 17 Langeac !). Ainsi, dans la stalle du prévôt de Brioude, voit-on se succéder après les membres de la famille Roger de Beaufort, Armand de Langeac en 1383 et Dracon de Lastic en 1385…


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
