Paul-Barthélémy d’Hotman (1752-1828)
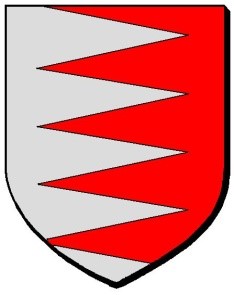 Jean-Antoine-François-Paul-Barthélémy naquit le 24 août 1752 à Eyguières et y reçut le baptême le lendemain. Son père, Joseph d’Autheman, tantôt qualifié de noble ou de bourgeois, descend d’une lignée d’avocats au parlement ; sa mère, Scipione de Damian, appartient à la famille des seigneurs de Vernègues qui lui fournit ses parrain et marraine : son oncle maternel, Paul Laugier de Lamanon et sa tante maternelle, Françoise-Marie de Châteauneuf. Entré dans le clergé d'Avignon, licencié in utroque, Paul-Barthélémy obtient une stalle au chapitre de Pignans avec la prébende de prieur du Saint-Sépulcre à Gonfaron, dont la paroisse dépend de la collégiale de Pignans ; il en hérita de son grand-oncle Henri-François de Damian auquel il succéda en 1770, et il la conserva jusqu’à la Révolution française. Il n'est encore que diacre en décembre 1781 quand il est pressenti pour la cure de Cotignac dont il prend possession après la mort de Messire Antoine Gerbaud, le 27 octobre 1789, ayant été ordonné prêtre entre temps. Les évènements ne lui permettront pas d'en jouir très longtemps.
Jean-Antoine-François-Paul-Barthélémy naquit le 24 août 1752 à Eyguières et y reçut le baptême le lendemain. Son père, Joseph d’Autheman, tantôt qualifié de noble ou de bourgeois, descend d’une lignée d’avocats au parlement ; sa mère, Scipione de Damian, appartient à la famille des seigneurs de Vernègues qui lui fournit ses parrain et marraine : son oncle maternel, Paul Laugier de Lamanon et sa tante maternelle, Françoise-Marie de Châteauneuf. Entré dans le clergé d'Avignon, licencié in utroque, Paul-Barthélémy obtient une stalle au chapitre de Pignans avec la prébende de prieur du Saint-Sépulcre à Gonfaron, dont la paroisse dépend de la collégiale de Pignans ; il en hérita de son grand-oncle Henri-François de Damian auquel il succéda en 1770, et il la conserva jusqu’à la Révolution française. Il n'est encore que diacre en décembre 1781 quand il est pressenti pour la cure de Cotignac dont il prend possession après la mort de Messire Antoine Gerbaud, le 27 octobre 1789, ayant été ordonné prêtre entre temps. Les évènements ne lui permettront pas d'en jouir très longtemps. ![]() Le chanoine d’Hotman se trouvait à la Guadeloupe (son frère Joseph-Marie (1754-1833) était déjà marié depuis plus de huit ans à l’Ile Maurice où il avait fait souche) à l’époque des premières lois sur l’émigration et fut donc porté sur les listes des émigrés au 22 vendémiaire an III. Au rétablissement du culte le ci-devant chanoine retrouva une stalle de chanoine honoraire de la métropole Saint-Sauveur d’Aix. Mais à l’heure de la reconstruction du diocèse de Fréjus, il se mit au service de Mgr de Richery. L’évêque lui donna le titre de vicaire général et l’intégra comme chanoine titulaire au nouveau chapitre, lors de sa toute première promotion du 30 novembre 1823. Il y remplit la fonction de Grand-chantre. Le chanoine d’Hotman mourut à Fréjus le 24 octobre 1828.
Le chanoine d’Hotman se trouvait à la Guadeloupe (son frère Joseph-Marie (1754-1833) était déjà marié depuis plus de huit ans à l’Ile Maurice où il avait fait souche) à l’époque des premières lois sur l’émigration et fut donc porté sur les listes des émigrés au 22 vendémiaire an III. Au rétablissement du culte le ci-devant chanoine retrouva une stalle de chanoine honoraire de la métropole Saint-Sauveur d’Aix. Mais à l’heure de la reconstruction du diocèse de Fréjus, il se mit au service de Mgr de Richery. L’évêque lui donna le titre de vicaire général et l’intégra comme chanoine titulaire au nouveau chapitre, lors de sa toute première promotion du 30 novembre 1823. Il y remplit la fonction de Grand-chantre. Le chanoine d’Hotman mourut à Fréjus le 24 octobre 1828.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
