Mgr Jean Hazera (1837-1905), chanoine d’honneur
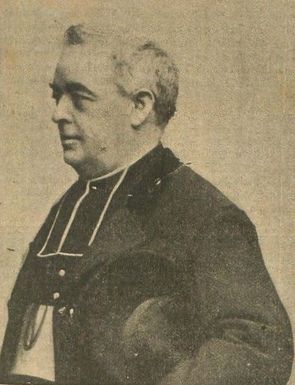
 Jean Hazera nait à Podensac le 1er janvier 1837, dans une famille de marins. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Bordeaux le 20 décembre 1862. Il débuta dans l’enseignement et fut professeur d’humanités et d’histoire au collège de Bazas. Après avoir été vicaire à Saint-Louis de Bordeaux dont le curé malade lui laissa pratiquement la charge de la paroisse, il fut nommé curé d’Ambarès-et-Lagrave, puis revint à Bordeaux, à la cure de Sainte-Marie de la Bastide. Nommé évêque de Digne le 19 avril 1897, il fut sacré le 5 septembre par l’archevêque d’Aix assisté de l’évêque de Gap et de Mgr Mignot, évêque de Fréjus, qui le fera chanoine d’honneur de sa cathédrale en 1898. Dans le gouvernement de son diocèse, il se révéla ce qu’il avait toujours été : un homme qui se donnait tout entier, avec une foi profonde, une profondeur intellectuelle et théologique et un rare talent d’organisateur. Il se mit au travail avec ardeur et s’y épuisa en peu d’années : retraites sacerdotales mensuelles, réforme des séminaires, rédaction d’un nouveau catéchisme et mise en place de structures pour répondre à la persécution qui s’abattait sur l’Eglise de France, rédaction de statuts diocésains, etc. Cet immense labeur fut interrompu par la maladie, puis la mort qui survint le même jour que pour son confrère de Fréjus, Mgr Arnaud, le 17 juin 1905. Ses funérailles furent célébrées le jeudi 22 juin 1905 sous la présidence de l’archevêque d’Avignon. C’est lui, Mgr Hazera, qui avait prononcé au Sacré-Cœur de Montmartre le 29 novembre 1899, le discours d’inauguration du monument à la mémoire de Louis Veuillot dont il avait été l’ami.
Jean Hazera nait à Podensac le 1er janvier 1837, dans une famille de marins. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Bordeaux le 20 décembre 1862. Il débuta dans l’enseignement et fut professeur d’humanités et d’histoire au collège de Bazas. Après avoir été vicaire à Saint-Louis de Bordeaux dont le curé malade lui laissa pratiquement la charge de la paroisse, il fut nommé curé d’Ambarès-et-Lagrave, puis revint à Bordeaux, à la cure de Sainte-Marie de la Bastide. Nommé évêque de Digne le 19 avril 1897, il fut sacré le 5 septembre par l’archevêque d’Aix assisté de l’évêque de Gap et de Mgr Mignot, évêque de Fréjus, qui le fera chanoine d’honneur de sa cathédrale en 1898. Dans le gouvernement de son diocèse, il se révéla ce qu’il avait toujours été : un homme qui se donnait tout entier, avec une foi profonde, une profondeur intellectuelle et théologique et un rare talent d’organisateur. Il se mit au travail avec ardeur et s’y épuisa en peu d’années : retraites sacerdotales mensuelles, réforme des séminaires, rédaction d’un nouveau catéchisme et mise en place de structures pour répondre à la persécution qui s’abattait sur l’Eglise de France, rédaction de statuts diocésains, etc. Cet immense labeur fut interrompu par la maladie, puis la mort qui survint le même jour que pour son confrère de Fréjus, Mgr Arnaud, le 17 juin 1905. Ses funérailles furent célébrées le jeudi 22 juin 1905 sous la présidence de l’archevêque d’Avignon. C’est lui, Mgr Hazera, qui avait prononcé au Sacré-Cœur de Montmartre le 29 novembre 1899, le discours d’inauguration du monument à la mémoire de Louis Veuillot dont il avait été l’ami.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
