Jacques Jeancard (1799-1875)

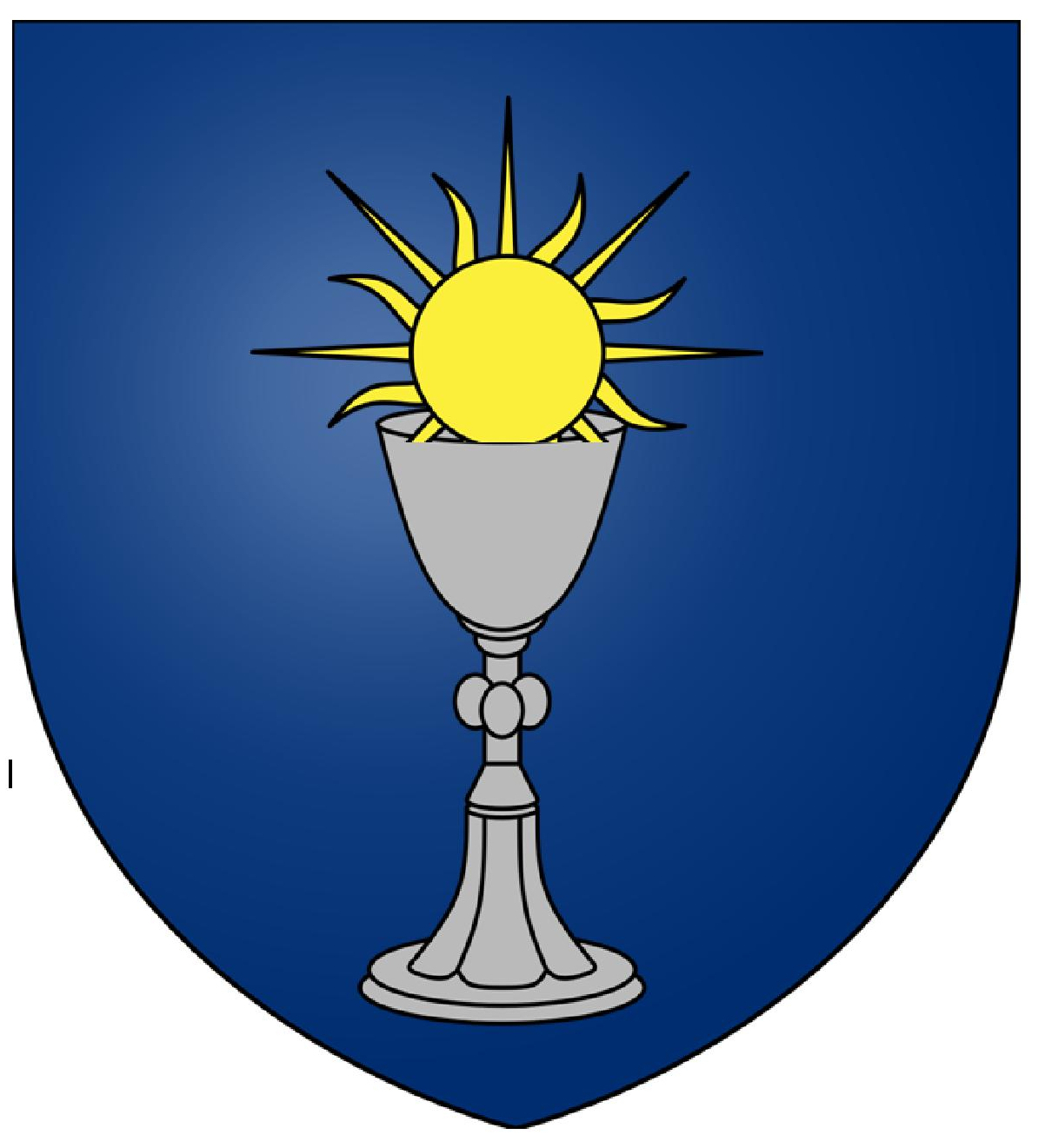 Jacques Jeancard, né à Cannes, diocèse de Fréjus, le 2 décembre 1799, reçoit au baptême les prénoms de Jacques Marie Joseph. Aîné de la famille, il avait un frère et une sœur qui devint religieuse et supérieure générale des Sœurs de Sainte-Marthe. Il fit ses études secondaires au collège de Grasse, dirigé par quelques membres de l'ancien Oratoire. À 16 ans, il manifesta à sa famille le désir de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique. Son père le retira alors du collège pour l'employer dans sa maison de commerce. Après une année et demie de travail, Jacques obtint la permission d'aller faire sa rhétorique et demeura ensuite une autre année comme professeur au collège. Au mois d'octobre 1818, il entra au grand séminaire d'Aix, dirigé par les Sulpiciens. C’est à ce moment qu’il entre en contact avec saint Eugène de Mazenod. Après une retraite d'une semaine, il commence le noviciat des Pères Missionnaires de Provence à Notre-Dame du Laus le 21 décembre 1821, fait son oblation à Notre-Dame du Laus le 30 mai 1822 et continue l'étude de la théologie comme externe au grand séminaire d'Aix.
Jacques Jeancard, né à Cannes, diocèse de Fréjus, le 2 décembre 1799, reçoit au baptême les prénoms de Jacques Marie Joseph. Aîné de la famille, il avait un frère et une sœur qui devint religieuse et supérieure générale des Sœurs de Sainte-Marthe. Il fit ses études secondaires au collège de Grasse, dirigé par quelques membres de l'ancien Oratoire. À 16 ans, il manifesta à sa famille le désir de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique. Son père le retira alors du collège pour l'employer dans sa maison de commerce. Après une année et demie de travail, Jacques obtint la permission d'aller faire sa rhétorique et demeura ensuite une autre année comme professeur au collège. Au mois d'octobre 1818, il entra au grand séminaire d'Aix, dirigé par les Sulpiciens. C’est à ce moment qu’il entre en contact avec saint Eugène de Mazenod. Après une retraite d'une semaine, il commence le noviciat des Pères Missionnaires de Provence à Notre-Dame du Laus le 21 décembre 1821, fait son oblation à Notre-Dame du Laus le 30 mai 1822 et continue l'étude de la théologie comme externe au grand séminaire d'Aix.
Fin 1822 furent rétablis simultanément les sièges épiscopaux de Marseille et de Fréjus. Alors qu’Eugène de Mazenod et un autre de ses confrères acceptaient de devenir vicaires généraux de Mgr Fortuné de Mazenod, nouvel évêque de Marseille, Mgr de Richery rappelait les prêtres originaires de son diocèse pour constituer son presbyterium. C’est ainsi que les Pères Deblieu et Maunier quittèrent les Missionnaires de Provence pour rejoindre le diocèse de Fréjus, ce dernier prenant la direction du nouveau séminaire ouvert le 30 novembre 1823. C’est là que Jacques Jeancard, qui les avait suivis, entra le 30 novembre 1823 pour terminer sa formation sacerdotale. Il reçut la prêtrise des mains de Mgr de Richery le 23 décembre suivant et fut nommé vicaire à Pourrières.
Saint Eugène de Mazenod qui avait fort mal vécu les départs successifs garde le contact, il écrit le 31 octobre 1823 : «J'attends ces infidèles à l'heure de la mort. Jeancard n'a pas attendu ce moment pour être rongé de remords; il m'a écrit deux lettres qui font pitié et m'inspirent la plus grande compassion.» Sa correspondance avec l’abbé Jeancard lui permit de réintégrer sa congrégation, avec l'accord de Mgr de Richery.
Le père Jeancard est affecté à la maison du Calvaire à Marseille à la fin d'octobre 1824, chargé de faire le catéchisme aux pauvres qu'on réunissait deux fois par semaine. Dès novembre, il participa à sa première mission à Allauch. Membre du Chapitre général de la congrégation, en juillet 1826, il fut présent à la promulgation des Règles approuvées par Léon XII et prononça de nouveau ses vœux, cette fois comme Oblat de Marie Immaculée. Pendant ses dix années de vie oblate, le père Jeancard a d'abord travaillé à Marseille, puis à Notre-Dame du Laus en 1828-1829 et enfin à Aix. Il a prêché une dizaine de missions, surtout de 1824 à 1829 ; il se pliait toutefois avec difficulté à la simplicité et au genre que le fondateur désirait, c'est pourquoi celui-ci lui confia surtout des sermons de circonstance.
Après la Révolution de Juillet 1830 le ministère des missions fut prohibé par le gouvernement; Jeancard se vit confier l'enseignement du dogme au séminaire de Marseille en 1831-1832, et de l'Écriture sainte en 1832-1833. Dans cette vie en milieu fermé, il ne tarda pas à manifester les défauts de son caractère. Mgr Eugène de Mazenod le reprend alors, les lui faisant remarquer : sensibilité à l'excès, prévenances contre certains pères, répugnances pour divers ministères.
Pendant l'été 1834, le Père Jeancard est autorisé à aller se reposer dans sa famille. De Cannes, il écrit alors pour demander la dispense des vœux afin, dit-il, d'aider ses parents et de retrouver la paix de conscience qu'il a perdue parce qu'il s'est constamment trouvé en opposition avec ses devoirs religieux. Dans la séance du 23 juillet 1834, le conseil général de la congrégation décide à l'unanimité de lui accorder la dispense demandée parce que, en effet, l'irrégularité du sujet «produit un mauvais effet sur la communauté»; «ce qui est plus grave, ajoute-t-on, c'est son caractère inquiet, son esprit critique et une certaine insubordination naturelle qui le rendent à charge aux supérieurs et très pénible à ses frères.»
Pour autant, il garda l’amitié et la confiance de Mgr Eugène de Mazenod qui lui fit intégrer le presbyterium de Marseille. En 1834, il est nommé aumônier de l'orphelinat de la Grande Miséricorde (il était déjà aumônier des prisons). Ses difficultés avec la congrégation n’empêchent pas de reconnaître ses qualités intellectuelles, son travail très approfondi des Pères et des philosophes, de la théologie morale aussi, sa prodigieuse mémoire, ses capacités pour écrire également, qui lui valent de servir de secrétaire aux deux évêques de Mazenod. En 1835, il est promu chanoine honoraire de Marseille, puis chanoine titulaire en 1836. En 1840, il est chargé de l’éloge funèbre de Mgr Fortuné de Mazenod. Succédant à son oncle comme évêque de Marseille, Mgr Eugène de Mazenod le nomme archidiacre de Notre-Dame des Accoules en 1842, puis en fait son vicaire général en 1844. Il accompagna son évêque dans ses voyages dans le Nord de l'Italie et en Algérie en 1842, à Rome en 1845 et en 1854, à Paris en 1856, 1857 et 1858. Lorsqu'on introduisit l'enseignement régulier de l'histoire de l'Église au séminaire de Marseille, c'est au chanoine Jeancard qu'on le confia : il l’assuma de 1844 à 1857. Le 18 mars 1858 il est choisi comme évêque auxiliaire de Marseille avec le titre d’évêque de Ceramus, et consacré le 28 octobre de la même année par saint Eugène assisté de Mgr Jordany, évêque de Fréjus, et de Mgr Ginoulhiac, évêque de Grenoble. A la mort de l’évêque de Marseille, en 1861, il est élu vicaire capitulaire. C’est encore lui qui prononce l’éloge funèbre de saint Eugène.
L’évêque aurait voulu faire de lui son coadjuteur, mais c’est un nouvel évêque qui arriva, qui voulut écarter tous les collaborateurs du prédécesseur. A cette fin, Mgr Jeancard fut nommé au chapitre de Saint-Denis. « Bien triste », il se retira alors à Cannes. C’est à ce moment, en 1862, que Mgr Jordany lui conféra la dignité de chanoine d’honneur de Fréjus. Sa retraite fut marquée par sa participation au concile du Vatican où il accompagna Mgr Guibert, archevêque de Tours, ancien oblat de Marie Immaculée et compagnon de l’époque du séminaire d’Aix. Lorsque celui-ci fut transféré à Paris en 1871, il appela auprès de lui Mgr Jeancard qui, pendant trois ans, fit office d’auxiliaire à ses côtés, sans en avoir le titre. Il tomba malade en juillet 1874 et se retira à Cannes où, après une année de maladie, il mourut le 6 juillet 1875. Mgr Jeancard était chevalier de la Légion d'honneur.


 Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.
